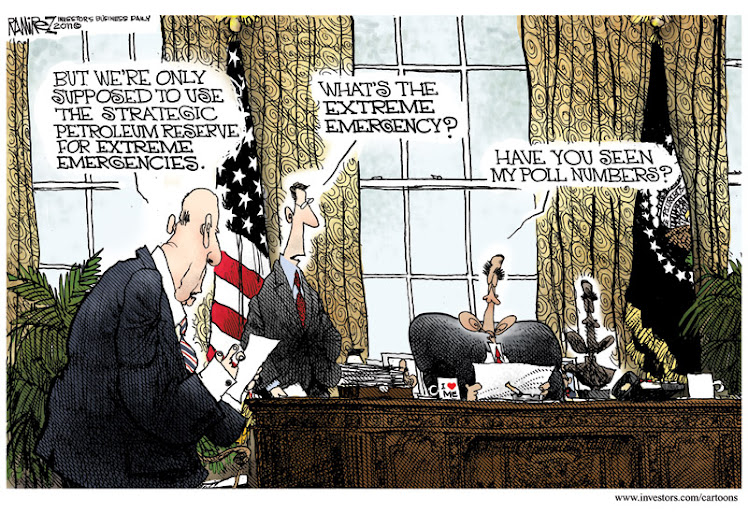Le Monde.fr
|
Philosophe, écrivain et essayiste, Umberto Eco est mort à 84 ans, vendredi soir 19 février, à son domicile, à Milan, d’un cancer, a confirmé sa famille au quotidien italien La Repubblica.
Pionnier de la sémiotique – la science des signes – et théoricien du langage (notamment de la réception), ce qui court en filigrane tout au long de son œuvre romanesque, auteur de nombreux essais sur l’esthétique et les médias, il a écrit tardivement son premier roman, qui connaît un succès considérable, Le Nom de la rose, paru en 1980 chez Fabbri-Bompiani. Cette enquête policière au sein d’une communauté religieuse au XIVe siècle, traduite en une quarantaine de langues et adaptée au cinéma, lui assura une notoriété quasi universelle.Né dans le Piémont, à Alessandria, le 5 janvier 1932, au sein d’une famille de la petite bourgeoisie – son grand-père est un enfant trouvé et son père, aîné de 13 enfants, est le premier à passer du monde des prolétaires à celui des employés –, Umberto Eco grandit sur fond de guerre et de maquis (« entre 11 ans et 13 ans, j’ai appris à éviter les balles », confiait exceptionnellement cet homme rétif à toute confidence intime). Au terme d’études supérieures de philosophie et d’esthétique à Turin, il soutient, en 1954, sous la direction du philosophe antifasciste Luigi Pareyson, une thèse de fin d’études sur l’esthétique chez Thomas d’Aquin, Il Problema estetico in Tommaso d’Aquino, qui sera publiée en 1956.
Mais Eco n’en reste pas à l’étude théorique. Dès 1955, il est assistant à la télévision et travaille sur les programmes culturels de la chaine publique italienne, la RAI. Tandis qu’il se lie d’amitié avec le musicien Luciano Berio, il intègre la Neoavanguardia qui, bien que « de gauche », rejette la littérature « engagée » ; ainsi, Eco collabore, à partir de 1956, aux revues Il Verri et Rivista di estetica.
Il dirige, en 1960, une collection d’essais philosophiques pour l’éditeur milanais Bompiani, et prolonge l’aventure collective, en participant, en 1963, avec de jeunes intellectuels et artistes de sa génération, tels Nanni Balestrini et Alberto Arbasino, à la fondation du Gruppo 63, où la réflexion sur une esthétique nouvelle s’inscrit dans le sillage de Joyce, Pound, Borges, Gadda – autant d’auteurs essentiels pour Umberto Eco. Avant l’austère mensuel Quindici, lancé en juin 1967, futur creuset des mouvements de 1968, la même équipe lance une revue de culture contemporaine – art, littérature, architecture, musique – Marcatré (1963-1970), tandis que le jeune penseur, attiré par le journalisme, commence une collaboration durable avec la presse (The Times Literary Supplement, dès 1963 et L’Espresso, dès 1965).
Mais il n’abandonne pas l’enseignement : de 1966 à 1970, il exerce successivement à la faculté d’architecture de Florence et à celle de Milan et intervient aussi à l’université de Sao Paulo (1966), à la New York University (1969) et à Buenos Aires (1970).
En 1971, l’année même où il fonde Versus, revue internationale des études sémiotiques, Eco enseigne cette science à la faculté de lettres et de philosophie de Bologne, où il obtient la chaire de la discipline, en 1975. Pour Eco, cette science expérimentale inaugurée par Roland Barthes est, plus qu’une méthode, une articulation entre réflexion et pratique littéraire, cultures savante et populaire. Il le prouve magistralement, lors de sa leçon au Collège de France, dont il a été le titulaire de la chaire européenne en 1992 (« La quête d’une langue parfaite dans l’histoire de la culture européenne »). Fort de sa notoriété et mû par une incroyable énergie, Eco dirige également l’Institut des disciplines de la communication et préside l’International Association for Semiotic Studies.
Pour un engagement critique envers les médias
Ses premières expériences à la télévision italienne ont très tôt familiarisé Umberto Eco à la communication de masse et aux nouvelles formes d’expression, comme les séries télévisées ou le monde de la variété. Il y découvre le kitsch et les vedettes du petit écran. Autant d’aspects de la culture populaire qu’il aborde dans Apocalittíci e Integrati (Bompiani, 1964), La Guerre du faux, recueil publié en France, en 1985, chez Grasset, à partir d’articles écrits entre 1973 et 1983, et De Superman au surhomme (1976-1993).Dans Apocalittíci e Integrati, notamment, il distingue, dans la réception des médias, une attitude « apocalyptique », tenant d’une vision élitaire et nostalgique de la culture, et une autre, « intégrée », qui privilégie le libre accès aux produits culturels, sans s’interroger sur leur mode de production. A partir de là, Eco plaide pour un engagement critique à l’égard des médias. Ensuite, ses recherches l’amèneront à se pencher sur les genres considérés comme mineurs – tels le roman policier ou le roman-feuilleton, dont il analyse les procédés et les structures –, mais également sur certains phénomènes propres à la civilisation contemporaine, comme le football, le vedettariat, la publicité, la mode ou le terrorisme. D’où son active participation aux débats de la cité, qu’elle soit à l’échelle locale ou à l’échelle planétaire…
Lire notre interview réalisée pour son dernier livre :
Umberto Eco : « Que vive le journalisme critique ! »
Si la curiosité et le champ d’investigation d’Umberto Eco connaissent
peu de limites, la constante de son analyse reste la volonté de « voir du sens là où on serait tenté de ne voir que des faits ». C’est dans cette optique qu’il a cherché à élaborer une sémiotique générale, exposée, entre autres, dans La Structure absente (Mercure de France, 1972), Le Signe, histoire et analyse d’un concept (Editions Labor, 1988), plus encore dans son Traité de sémiotique générale (Bompiani, 1975). Ainsi contribue-t-il au développement d’une esthétique de l’interprétation.Il se préoccupe de la définition de l’art, qu’il tente de formuler dès L’Œuvre ouverte (Points, 1965), où il pose les jalons de sa théorie, en montrant, au travers d’une série d’articles qui portent notamment sur la littérature et la musique, que l’œuvre d’art est un message ambigu, ouvert à une infinité d’interprétations, dans la mesure où plusieurs signifiés cohabitent au sein d’un seul signifiant. Le texte n’est donc pas un objet fini, mais, au contraire, un objet « ouvert » que le lecteur ne peut se contenter de recevoir passivement et qui implique, de sa part, un travail d’invention et d’interprétation. L’idée-force d’Umberto Eco, reprise et développée dans Lector in Fabula (Grasset, 1985), est que le texte, parce qu’il ne dit pas tout, requiert la coopération du lecteur.
Aussi le sémiologue élabore-t-il la notion de « lecteur modèle », lecteur idéal qui répond à des normes prévues par l’auteur et qui non seulement présente les compétences requises pour saisir ses intentions, mais sait aussi « interpréter les non-dits du texte ». Le texte se présente comme un champ interactif, où l’écrit, par association sémantique, stimule le lecteur, dont la coopération fait partie intégrante de la stratégie mise en œuvre par l’auteur.
Dans Les Limites de l’interprétation (Grasset, 1992), Umberto Eco s’arrête encore une fois sur cette relation entre l’auteur et son lecteur. Il s’interroge sur la définition de l’interprétation et sur sa possibilité même. Si un texte peut supporter tous les sens, il dit tout et n’importe quoi. Pour que l’interprétation soit possible, il faut lui trouver des limites, puisque celle-là doit être finie pour pouvoir produire du sens. Umberto Eco s’intéresse là aux applications des systèmes critiques et aux risques de mise à plat du texte, inhérents à toute démarche interprétative. Dans La Recherche de la langue parfaite dans la culture européenne (Seuil, 1993), il étudie ainsi les projets fondateurs qui ont animé la quête d’une langue idéale. Une langue universelle qui n’est pas une langue à part, langue originelle et utopique ou langue artificielle, mais une langue idéalement constituée de toutes les langues.
Un romancier à succès
Professeur, chroniqueur et chercheur, Eco a, tout au long de sa carrière, repris en recueil nombre de ses conférences et contributions, des plus humoristiques (Pastiches et postiches, chez Messidor, en 1988 ; Comment voyager avec un saumon, chez Grasset, en 1998) aux plus polémiques (Croire en quoi ?, chez Rivages, en 1998, Cinq questions de morale, chez Grasset, en 2000). Mais si, retrouvant le pari qu’il avait relevé pour Bompiani à la fin des années 1950 en réalisant une somme illustrée, La Grande histoire des inventions, il s’est essayé tardivement à de personnelles synthèses sur l’Histoire de la beauté (Seuil, 2004), de la laideur (2007) ou des lieux de légende (2013), en marge d’un saisissant Vertige de la liste (2009) dont le ton croise le savoir de l’érudit et la liberté de l’écrivain, Umberto Eco est également romancier.Ses œuvres de fiction sont d’une certaine façon l’application des théories avancées dans L’Œuvre ouverte ou Lector in Fabula. Ses deux premiers romans, Le Nom de la rose (1980 [1982]) et Le Pendule de Foucault (1988 [1990]), qui rencontrent contre toute attente un succès phénoménal, se présentent comme des romans où se mêlent ésotérisme, humour et enquête policière.
A chaque page, l’érudition et la sagacité du lecteur sont sollicitées par une énigme, une allusion, un pastiche ou une citation. Le premier roman, situé en 1327, en un temps troublé de crise politique et religieuse, d’hérésie et traque inquisitoriale, se déroule dans une abbaye où un moine franciscain, préfiguration de Sherlock Holmes, tente d’élucider une série de crimes obscurs. A partir de là, trois lectures sont possibles, selon qu’on se passionne pour l’intrigue, qu’on suive le débat d’idées ou qu’on s’attache à la dimension allégorique qui présente, à travers le jeu multiple des citations, « un livre fait de livres ». L’Umberto Eco lecteur de Borges et de Thomas d’Aquin est plus que jamais présent dans ce roman qui connut un succès mondial et fut adapté au cinéma par Jean-Jacques Annaud avec Sean Connery dans le rôle principal. Le Pendule de Foucault mêle histoire et actualité à travers une investigation menée sur plusieurs siècles, de l’ordre du Temple au sein des sectes ésotériques.
Troisième jeu romanesque, L’Île du jour d’avant (1994 [1996]) est une évocation de la petite noblesse terrienne italienne du XVIIe siècle. Le récit d’une éducation sentimentale, mais également, à travers une description de l’identité piémontaise, un roman nostalgique et en partie autobiographique : l’auteur se penche sur ses propres racines, comme il le fait plus tard dans son livre le plus personnel, La Mystérieuse Flamme de la reine Loana (2004 [2005]), sorte d’autoportrait déguisé en manteau d’Arlequin coloré d’images illustrées de l’enfance. Amnésique à la recherche de son passé, Yambo, double d’Eco, reconstruit son identité en s’appuyant sur ses lectures de jeunesse des années 1930, quand les romans d’aventures français et les bandes dessinées américaines concurrençaient la propagande fasciste. Cette échappée intime, exceptionnelle chez un homme dont la pudeur est la règle, est sans exemple.
De Baudolino (2000 [2002]), éblouissante chronique du temps de Frédéric Barberousse tenu par un falsificateur de génie, à Numéro Zéro (2015), fable aussi noire que féroce qui épingle la faillite contemporaine de l’information, en passant par Le Cimetière de Prague (2010 [2011]), où le thème du complot, si présent dans l’œuvre, est au cœur d’une fiction glaçante, Eco renoue avec une envergure plus large, des interrogations plus éthiques où l’érudition et la malice le disputent au jeu, sur le vrai et le faux, la forme aussi, puisque l’écrivain se plaît à croiser les registres et multiplier les défis.
Eco est un de ces noms donnés aux enfants sans identité, acronyme latin qui convoque la providence (« ex coelis oblatus », don des cieux en quelque sorte). Il fallait au moins ce clin d’œil pour le plus facétieux des érudits, le plus lettré des rêveurs. S’il parodiait Dante à 12 ans quand il se voulait conducteur de tramway, Umberto Eco désarme toujours autant les commentateurs. Philosophe destiné à intégrer la vénérable et très sélective Library of Living Philosophers, il semble toutefois promis à une postérité de romancier. Sorte de pic de la Mirandole converti à l’Oulipo, celui que le médiéviste Jacques Le Goff, qui conseilla au cinéaste du Nom de la rose, appelait « le grand alchimiste » est au moins à coup sûr l’idéal du penseur pluriel, de l’obsédé textuel, du lecteur amoureux.
-
Philippe-Jean Catinchi
Journaliste au Monde
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/disparitions/article/2016/02/20/umberto-eco-auteur-du-nom-de-la-rose-est-mort_4868787_3382.html#ThiXgkRmhmH4u1Vy.99