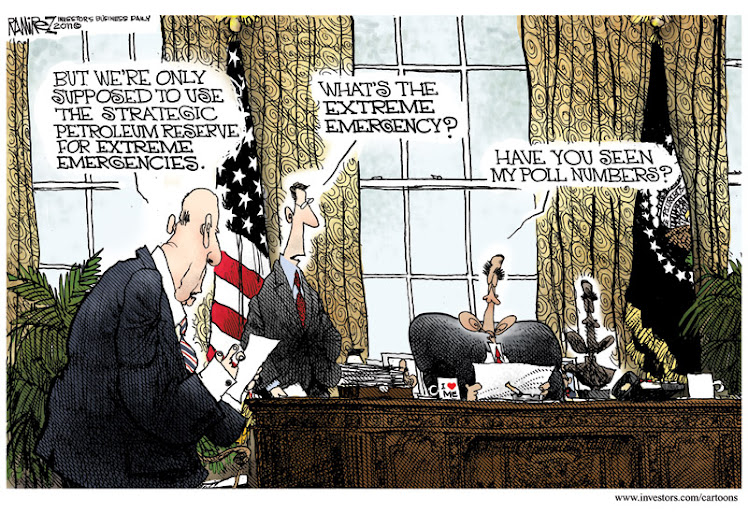Par: Jessica Dos Santos
Cet
après-midi du 27 février, il y a 29 ans, la ville brûlait sous les
braises du Caracazo, mais aujourd’hui elle est recouverte d’un
inhabituel froid intense, ce qui n’a pas empêché les gens de se
mobiliser pour accompagner le Président lors du dépôt de sa candidature à
la réélection.
C’est
de là que revenait Iraida, portant une veste noire et des tennis marron
qui semblaient bien fragiles pour une pareille marche. Elle prit une
chaise en plastique et s’assit à mon côté : « Moi j’aime marcher »
m’a-t-elle déclaré, tout en ôtant un peu ses chaussures.
Nous nous trouvions au Campement des Pionniers “Combattants
de ma Patrie”, à l’intersection de Miguelacho et Tracabordo, à La
Candelaria, où autrefois il y avait d’ordinaire un stationnement dont
subsistent encore les postes de surveillance. Autour de nous, des jeunes
s’affairent à réparer une moto sur le point de rendre l’âme.
“Ici personne ne nous aimait, et on se faisait huer,
mais aujourd’hui ils nous acceptent et nous, on aide les gens à faire
leurs courses, on leur monte les bouteilles de gaz, nous organisons des
ventes de poisson, nous essayons de leur faire voir que nous n’allons
pas apporter d’insécurité,” me dit Iraida, tandis que deux gamins jouent
au basket et que des jeunes-filles interrompent la confection d’une
banderole, pour préparer du café.
Iraida fait partie du Movimiento Pobladores y Pobladoras de Venezuela (Le mouvement des occupants et occupantes du Venezuela),
un regroupement né en 2002, qui rassemble les Comités des Terres
Urbaines, les Travailleuses de l’Habitat (Residenciales), le Movimiento de Inquilinos Mouvement des locataires, les Campements de Pionniers, parmi d’autres. Tous avec un même objectif : le droit à un logement (et un habitat) digne.
Un
droit difficile à conquérir quand on se trouve dans le pays le plus
urbanisé de l’hémisphère (le Venezuela) où près de 90% de la population
vit dans des villes et 60% dans des quartiers auto-construits, sans
sécurité juridique sur le terrain qu’ils occupent et, souvent, dans des
conditions de grande vulnérabilité.
“Ma
situation en matière de logement, avant de me marier, était
« normale » ; c’est-à-dire que je vivais chez mes parents, un espace
très modeste, au Quartier 5 de Julio, à Petare ; je me suis mariée en 92
et nous avons alors loué une toute petite maison dans le secteur de La
Capilla ; après quoi ça n’a été que des allées et venues, j’ai dû
déménager tous les 2 ou 4 ans » se souvient-elle. Elle a aussi vécu dans
l’Impasse Urdaneta, rue Guaicaipuro, etc…, toujours à l’intérieur du
même quartier. De tous ces logements, elle a dû partir contrainte et
forcée, tout comme elle apprit à ses dépens les différentes modalités
d’expulsion qui peuvent coexister dans ce système.
“Je
faisais un travail social , mais, en plus, mon frère était entré dans
les rangs du parti Bandera Roja, et moi je finis par être une sorte
d’alliée, celle qui a des tâches spécifiques ; mais ils rasaient les
maisons, quelques-unes des camarades finirent en prison, et cela en
quelque sorte me barra dans le quartier, c’est-à-dire que les gens
éprouvèrent une certaine peur à me fréquenter”, me raconte-t-elle.
Cependant Chavez devint président et des choses commencèrent à changer.
“Le décret 1666, sur les Comités de Terres Urbaines est promulgué. Avant,
tous les quartiers déshérités étaient considérés comme zones vertes,
mais Chavez nous donna ce décret, cette reconnaissance, titres de
propriété, travaux d’amélioration, à partir de cela je me suis
totalement engagée dans les rangs chavistes”.
C’est
alors que je me suis souvenue de la communication de l’une des
dernières feuilles de route de Chavez que je devais couvrir : à côté de
l’emblématique « mur » de Petare. Cependant c’est un autre jour que se
remémora Iraida, lorsque le Commandant alla remettre des titres de
propriété de terrains à La Vega et qu’elle entra dans une colère noire :
“J’étais
contrariée car ils ne prenaient en compte que ce secteur, alors nous
avons bloqué une rue et nous avons protesté. Mais est arrivée María
Cristina Iglesias et elle nous a envoyés au bureau technique national,
j’y suis allée, j’ai réclamé et ils m’ont offert du travail. La femme
m’a dit : si tu ne veux pas que cela continue, eh bien, viens et
organise-toi ”.
Alors
Iraida s’est intégrée. “Et puis après avoir remis de très nombreux
titres de propriété, c’est moi qui ai été délogée. Et sais-tu pourquoi ?
En tant que chaviste, cela s‘est passé pendant la tentative de coup
d’Etat contre Chavez ”.
En
effet, Iraida a déménagé, mais pour une autre maison du même quartier:
“J’avais la facilité de tout connaître, d’être dans les comités, de les
avoir recensés (…)mais, après les premières barricades de rue, quelque
chose a changé, c’était un quartier uni, avec une forte opposition,
certains très très proches de la droite, cependant il y avait du
respect, jusqu’à ce que commencent à surgir des situations d’insécurité
bien mystérieuses ”.
Le
regard d’Iraida se perd dans le fond du campement où l’on aperçoit des
tables organoponiques en construction. “L’angoisse est arrivée, la
terreur, beaucoup croyaient qu’il s’agissait d’une lutte pour un secteur
de drogue, mais non, ceux qui s’incorporent au travail, qui respectent
les gamins, s’occupent des autres, commencèrent à être assassinés, ils
nous enlevèrent notre protection et le niveau d’insécurité a augmenté
(…) ils se mirent à tuer les gens qui vivaient autour de moi, ils mirent
le feu au troisième étage de ma maison, jusqu’à ce que quelqu’un me
dise ; tu ne crois pas que tu devrais partir ?”
Moi
je ne comprenais pas encore ce que tout cela avait à voir avec le
mouvement, avec le droit au logement, jusqu’à ce qu’elle décrète :
“C’est le niveau d’expulsion le plus révoltant qui existe, parce que,
s’ils essaient de te déloger par une augmentation de loyer, bon, tu te
mets à te battre ou tu cherches une solution, mais si l’on t’expulse en
te disant « tu t’en vas ou on te tue» , c’est différent, c’est comme si
tous les matins quand tu te lèves on te braquait un pistolet contre la
tempe. Ils voulaient que je m’en aille de chez moi et du quartier.
Iraida
éclate en sanglots, je ne sais pas bien que faire, il y a quelques
minutes à peine nous étions des inconnues l’une pour l’autre , mais,
soudain, à travers son récit, nous devenions une même personne, je
tendis ma main et ne parvins qu’à susurrer un timide: “allez, ça va
aller”. Mais elle insista:
“En
plus c’est une forme d’expulsion que les gens ne voient pas, ne
remarquent pas car personne ne porte plainte, contre qui vas-t-u porter
plainte ? On te vole ta nuit (…) On a vécu une guerre et nous n’en avons
pas eu conscience (…) Moi, parfois j’y retourne, quand le quartier est
tranquille, je suis contente de les voir, ils sont contents de me voir,
mais il y a des endroits où je n’ai pu retourner, trop de souvenirs, je
te parle de plus de dix personnes tuées d’un coup ”.
C’est
ainsi qu’Iraida finit par être délogée de Petare. Elle se trouve
aujourd’hui dans une commune proche, mais dans une autre ambiance : “Je suis allée temporairement dans un campement, à Chacao, une
belle communauté, avec des gens unis malgré les différences, cependant
là aussi il y avait des embrouilles à tout instant, car les flics de
Chacao intervenaient etc,,, mais moi je me sentais protégée parce que
tout le monde défendait l’espace, ici nous savons que personne n’est
seul ”.
“Mais
dans le quartier ils sont plus nombreux ”, insisté-je. “Oui, mais dans
le quartier ils sèment la terreur et nous isolent, au point que parfois
les gens ne sortent même pas voir ce qui est arrivé, lorsqu’ils ont tué
mon ex beau-père à Petare, d’une balle dans la tête, j’ai demandé de
l’aide aux gens et personne ne voulait aider, il n’a pas été facile de
trouver une voiture pour l’emmener à l’hôpital”.
Iraida me dit qu’au “Campamento de Pioneros 22 de enero” elle a eu un hébergement de solidarité, cependant ce n’est pas là qu’elle fixera ses racines.
“C’est transitoire, eux ne vivent pas encore par désir d’aboutir, mais
ils font leurs gardes, c’est un espace dédié (…) j’ai compris là que le
logement c’est un détail, le plus important est ce qui se cache
derrière : les gens ne cherchent pas un toit, ils cherchent leur
sécurité ”.
C’est
alors que l’alarme d’une voiture voisine se déclencha et, tandis que
des gens cherchaient à l’éteindre, j’en profitai pour boire la dernière
gorgée de café, pour sourire devant la présence d’une poule dans une
espèce de « cage » confectionnée avec des caisses du CLAP, et lâcher ma
dernière pointe d’amertume : tu as bien conscience que cela ne suffit
pas pour résoudre la question?
“Ce
n’est ni avec les deux millions de logements déjà livrés ni avec la
Grande Mission, que l’on résoudra tout le problème, mais ici et là on
obtient quelque chose, tu sais quoi ?L’espérance (…)Nous les pionniers nous nous battons pour vivre en commun et nous ne nous rendons pas
Tu
es sûre? “Moi, avec les Comités des Terres, j’allais empêcher des
expulsions, nous nous heurtions avec la police mais ils ne nous
délogeaient pas, nous sommes une plateforme, nous nous appuyons, et nous
recommençons comme au début parce qu’ici bien que l’expulsion par la
force soit interdite, des gens continuent d’être délogés et le négoce
immobilier s’est renforcé parallèlement à la crise”.
Au
Venezuela, comme dans le reste du monde capitaliste, le logement et la
ville sont un produit coûteux interdit à la grande majorité. Mais, le
Mouvement des Occupants et des Occupantes croit en la possibilité
d’inverser cette “logique”.
Traduction : Michele ELICHIRIGOITY
URL de cet article : https://wp.me/p2ahp2-48o