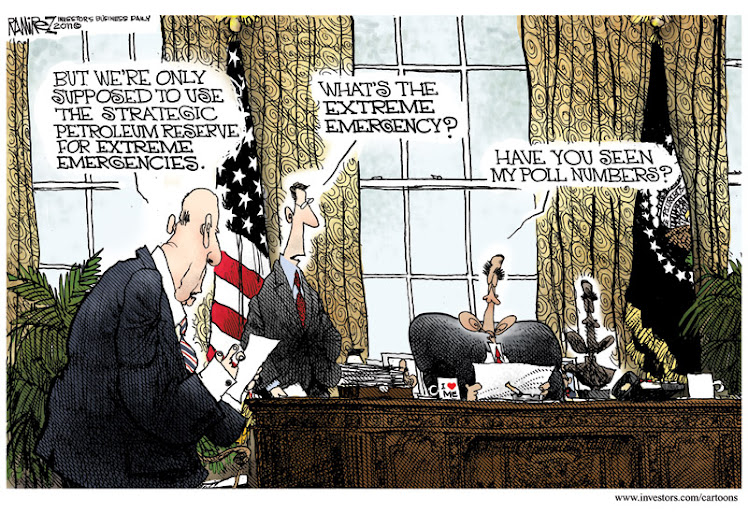par Thierry Deronne, Alto Apure, Venezuela, octobre 2019
par Thierry Deronne, Alto Apure, Venezuela, octobre 2019
« Nous
n’avions pas de terres mais ici nous pouvons offrir un futur à nos
enfants. C’est ce qui nous a motivées à participer en tant que mères.
Ils ne tomberont pas malades comme dans les villes. Ici, ils apprendront
à partager, à être humbles et respectueux » raconte Maria. « Ouiiii ! Ouiiii !» font les machettes affûtées sur la pierre plantée entre deux churuatas, cabanes
en forme d’étuves, aux toits de palmes, de planches et de zinc. L’une
sert aux paysan(ne)s de salle de réunion et de dortoir, l’autre de
cuisine. « C’est dans cette casserole qu’on a cuit le poisson ? Oui, ne jette pas l’eau ! »
Hommes et femmes de garde travaillent sans relâche à nourrir le
collectif. A cheval ou à pied, paysan(ne)s et fonctionnaires de l’Institut National des Terres
– qui sont ici des alliés – vont et viennent du camp de base à la terre
en friche pour démarquer les lots assignés aux 107 familles. Après
quinze ans d’attente, chaque agriculteur aura droit à neuf des 1200
hectares abandonnés. Erigé il y a dix mois au cœur de l’Alto Apure, le
campement « Hugo Rafael Chavez Frias », témoigne d’une grande force
d’organisation et d’une grande patience…
« Au
début nous avons marché, marché beaucoup, partout, pour retrouver les
chemins. Tout était recouvert par l’herbe et la forêt. La lutte a été
longue. En 2000 quand Chavez a encouragé les paysans nous avons pris la
terre mais on nous a demandé de suivre la voie légale. En 2006, en 2014,
à chaque occupation, nous sommes restés sans réponse de l’Institut des
Terres. Et puis nous nous sommes regroupés ici, en 2019. Il y a eu des
nuits où nous devions dormir debout car la pluie avait inondé le
campement. Qu’est-ce qu’on a ri, la nuit où le toit de plastique s’est
troué, et a douché José de la tête aux pieds ! Quand ue compagne a senti
un serpent dans son sac de couchage, elle a failli déchirer le hamac !
Il y a des jours où on ne peut pas même pas boire un café, il n’y a que
du pain et de l’eau. De six à neuf heures du soir, nous sommes mangés
par les moustiques. A l’aube ils reviennent, ils te rendent fou ! Celui
qui n’a pas l’habitude part en courant. Mais nous sommes des paysans.
Nous aimons travailler la terre, et travailler ensemble ! Avoir sa
parcelle, c’est le rêve ! Pouvoir cultiver ses bananes, ses haricots,
connaître de nouveaux amis ! Heureusement sous le gouvernement
révolutionnaire, cela nous est permis, et grâce à Dieu aussi, car pour
nous ce serait impossible d’acheter un lopin. Nous avons formé des
groupes armés, pour nous défendre, des équipes pour la cuisine, le bois,
l’eau. Et maintenant le toit ne laisse plus passer la pluie. »
« Qui vient avec nous ? » « On se rejoint au fleuve ? ».
La vase des étangs, les sentiers oubliés, les friches d’herbe se
réveillent à l’aube sous les bottes pressées. Les lames se fraient
pendant des heures un chemin dans la forêt de ronces et de roches.
Parfois un écho poursuit les pionniers : le bûcheron perdu, un
fantôme qui coupe des arbres et qu’on ne voit jamais. Mais rien, ni les
trombes de pluie ni les sangsues, n’arrête les trois arpenteurs de
l’Institut National des Terres qui s’enfoncent dans les rivières en
crue, GPS au-dessus de la tête, et qui se sont engagés à rester sur
place tant que la dernière parcelle ne serait pas démarquée. « 10% au moins de la zone restera vierge pour préserver la biodiversité »
précise un des ingénieurs de l’Institut des Terres. L’après-midi, un
groupe électrogène leur permet de transcrire les relevés. Un Etat au
service des paysans, des fonctionnaires travaillant et dormant sous le
même toit : une fraternisation dont Chavez avait rêvé.
La
pointe des machettes tatoue sur la boue séchée les futures parcelles de
cacao, maïs, banane plantain, haricots, ail, potiron, tomate,
tubercules – ocumo, manioc –, citron, avocat, abricot, noix de coco,
goyave et pourquoi pas, dans les marécages, un élevage de buffles, pour
la viande et le fromage. Les très poissonneux étangs et le fleuve
Uribante sont proches. « Ce que nous voulons, c’est produire. Pas
seulement pour nous, mais pour vendre au prix juste à la population
voisine, dans les grandes villes, dans les marchés populaires, et
pourquoi pas pour exporter. » Juchés sur une motte de terre, sous les branches d’un guarataro del llano, malgré la fatigue et entre deux averses, les dirigeants locaux et ceux de la Corriente Revolucionaria Bolívar et Zamora ont réuni l’assemblée. La Corriente est forte d’une expérience avancée de pouvoir populaire : elle a organisé près d’ici une vaste cité communale (1). Elle peut conseiller les 107 défricheurs de terre: « Sur
d’autres terres récupérées nous nous sommes entraidés en offrant trois
jours de travail les uns aux autres. Il y en a qui sont venus en rêvant
de négoces, mais sont vite partis quand on leur a parlé de socialisme et
de révolution. Chaque parcelle est le fruit de la lutte, pas question
que certains revendent la leur. Nous voulons travailler pour nourrir le
peuple. Pas comme ceux qui émigrent vers des pays voisins parce que la
télévision leur dit qu’on y gagne plus d’argent, et qui s’y font
exploiter à mort » explique Ovidio, pionnier de la lutte.

L’auteur
avec Betzany Guedez formatrice et réalisatrice de Terra TV et sa fille.
Campement « Hugo Rafael Chavez Frias », Alto Apure, Venezuela, octobre
2019.
Un
homme et une femme bien habillés débarquent en 4X4. Ils assistent à
l’assemblée, en retrait, visage tendu, lèvres serrées pendant l’hymne
national. « Nous sommes les héritiers de ces terres, nous avons les preuves, on ne nous a pas informés de ce qui se passe ici ». « Mais où est votre titre de propriété ? » interrogent les paysans. « Nous n’avons pas eu le temps de le photocopier ».
Quand on leur rappelle poliment que l’Institut des Terres a tranché en
faveur de ceux qui veulent semer (2), les « héritiers » menacent : « Nous avons de la famille dans le gouvernement.» Après leur départ, un paysan analyse : « Ils
parlent d’héritage mais que signifie ce mot puisqu’ils ont abandonné
ces terres ? Pour en hériter, il faudrait les mériter comme nous qui les
avons assez aimées pour les travailler ». Faut-il prendre au
sérieux ces personnages de telenovela ? Peut-être ne sont-ils venus que
pour quémander une parcelle, dans leur défaite ? Mais ailleurs les terratenientes
continuent à régner à coups d’assassinats. Les médias privés –
majoritaires au Venezuela – traitent les paysans d’« envahisseurs »,
justifiant la violence. Cinq compagnons et une compagne sont encore
tombés, le 27 juillet, sur la route de Ticoporo, d’une balle
paramilitaire dans la nuque. (3)
Ici,
aux croisements des états du Tachira, d’Apure et de Barinas, tout le
long de la frontière avec la Colombie, la souveraineté du Venezuela
vacille : le peso colombien a remplacé le bolivar. Le satellite diffuse
les télés colombiennes. Aux trafics en tout genre – billets de banque,
drogue, essence -, s’ajoutent les effets du blocus impérial: centres de
santé sans médicaments, réseaux sans électricité, machines agricoles
sans pièces de rechange. Les paysans s’organisent pour résister à la
guerre économique, aux menaces des mafias agraires, et, parfois, aux
maires, gouverneurs, fonctionnaires « chavistes » qui renouent avec les
pratiques politiques dénoncées par Chavez. « Nous soutenons à fond le
camarade Nicolas Maduro. Un autre gouvernement nous aurait déjà tous
massacrés. Mais s’il ne secoue pas l’Etat… s’il continue à négocier… »
A
chaque pas, la lutte révolutionnaire ouvre de nouvelles contradictions
(4). Au Venezuela le modèle urbain, celui du grand exode post-boom
pétrolier, a généré de curieux hybrides. Nous ne sommes ni à la campagne
ni dans de vraies villes : la délinquance tend à remplir le vide
d’identité sociale. Quand naîtra cette commune paysanne ? Quel sera son
visage ? On n’y a pas encore vraiment réfléchi. On attend surtout que
l’Etat remplisse sa fonction : électricité, internet, la route surtout,
le centre de santé, l’école… « Sur les terres nous avons réservé une
aire pour un terrain sportif, une école, un centre de santé, une église
car ici nous respectons le credo de chacun, et puis, nous aimerions
bénéficier d’une Mission du Logement paysan ».
Pour les vétérans de la Corriente, le thème crucial est d’organiser au plus vite la production, en évitant les dérives commerciales, et la formation. « Pour
éviter de vendre tous nos légumes en Colombie, nous devons créer un
espace commun de travail. Il faut développer la vision collective du
projet, et démontrer au gouvernement que c’est la meilleure des
alternatives. Penser « commune » avant lopin. Dans une commune, un
secteur peut produire de l’engrais pour tous les autres, par exemple.
Vous vous souvenez de la Commune « Brisas de Cano Amarillo », quand on
leur a dit que c’était impossible de cultiver 30 hectares sans machines,
ils ont récolté à la main et tout transporté jusqu’à la mairie ! C’est
ce genre d’expériences que nous devons transmettre. Et que nos futures
assemblées soient comme les premières, comme des retrouvailles… et
plutôt que de répéter mille fois « commune, conseils communaux… »,
regardons comment a fonctionné réellement l’auto-gouvernement en pleine
crise économique. Pour ne pas décevoir ceux qui viendront à l’assemblée,
il faut leur dire ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné. »
Sous
les discussions et les rires percent les motos, le ruminement intime
des chevaux, le bras de fer asthmatique de la pompe à eau, les
infatigables oiseaux, singes araguatos, grenouilles, d’une infinité à l’autre de ces terres où chaque famille rêve de construire son rancho. Bientôt viendra l’heure de semer. Et d’attendre la pluie. Et qu’elle ne soit pas trop forte. « L’espoir est la dernière chose que nous perdrons ».
T.D.
Ci-dessous:
une équipe de la télévision paysanne Terra TV (Betzany Guedez, Jorge
Henriquez, Thierry Deronne) réalise un documentaire en appui à la lutte
pour la terre des pionniers du campement « Hugo Rafael Chavez
Frias ». Surmontant une mauvaise fièvre, l’amie Danilsa, une
« commandante » de la « ciudad comunal », est venue de Chorrosquero,
avec dans son sac, le livre que j’avais publié chez l’éditeur bolivarien
Manuel Vadell, à Caracas : « Dix propositions pour créer une télévision socialiste ».
Il y a douze ans, avec une équipe de la télévision publique Vive TV,
nous étions venus former des militant(e)s de la Corriente Revolucionaria
Bolivar et Zamora, au langage de la caméra. Douze ans plus tard, la
ville communale a bien grandi, et ses défis aussi.
Notes :
- Site de ce mouvement social : http://www.crbz.org/
- Lorsque des paysans réclament le droit de semer des terres abandonnées, l’Institut National des Terres (https://twitter.com/INTi_Venezuela ) inspecte le domaine et le cas échéant, publie un avis d’abandon pour que l’éventuel propriétaire puisse faire valoir ses droits à la défense. S’il ne se manifeste pas, la loi dit que la terre doit être remise aux paysans en vertu du droit de la population à la souveraineté alimentaire.
- Voir http://www.crbz.org/masacre-en-barinas-contra-militantes-revolucionarios-comunicado-de-la-corriente/ et http://www.crbz.org/intervenciones-en-los-actos-homenajes-a-ls-martires-de-ticoporo/
- Lire les récits précédents : « Vivre le Venezuela » (1) https://wp.me/p2ahp2-4rZ et “Vivre le Venezuela” (2) https://wp.me/p2ahp2-4su