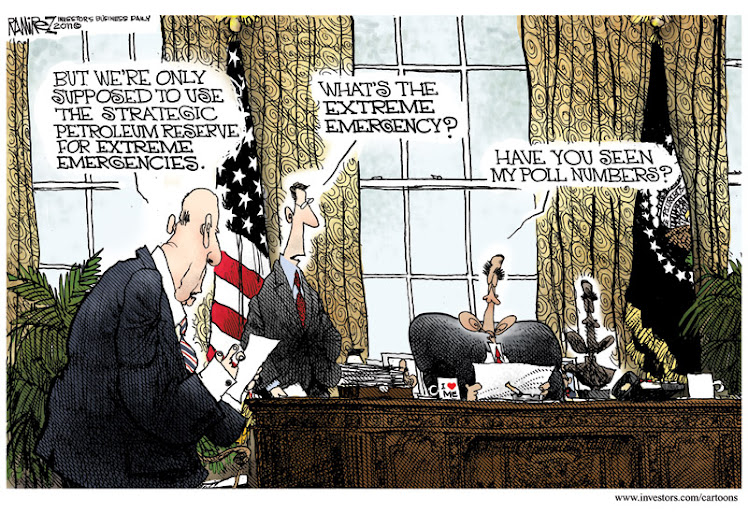Pour: Dominique Pestre
La production des savoirs ne se fait plus à l'abri de ses anciens lieux de prédilection, les académies et les universités, mais au sein des réseaux hétérogènes de la technoscience : tel serait le sens de l'histoire. Or, de Newton à Marie Curie, les exemples abondent pour montrer que, depuis longtemps, les savants ne sont pas restés confinés dans leur tour d'ivoire. Que signifie donc cette mise en scène ?
Ces dernières années, de nombreux textes ont été écrits sur les manières de faire de la science. De ceux qui ont eu les plus grands retentissements médiatiques il émerge une image assez homogène : le système de production des savoirs scientifiques et techniques est en profonde réorganisation, cela a des effets majeurs sur ce qu'on appelle la science, et ces effets sont épistémologiques autant que sociaux. Cette image a été particulièrement propagée par un livre qui, au sein des cercles de responsables en matière de politique scientifique, a été beaucoup lu et a fait l'objet de commentaires très élogieux. Sous le titre The New Production of Knowledge , il réunit les contributions de Michael Gibbons, ancien directeur du Science Policy Research Unit à Sussex ; de Camille Limoges, ancien secrétaire d'Etat à la recherche au Québec ; de Helga Novotny, Simon Schwartzman, Peter Scott et Martin Trow, tous professeurs et chercheurs reconnus (1).
La thèse centrale de ce livre est qu'un nouveau régime de production des savoirs, que M. Gibbons et ses collègues dénomment mode 2, est en train d'émerger à côté du régime classique qui a dominé depuis la révolution scientifique du XVIIe siècle. Pour celui-ci, dénommé mode 1, les questions et les problèmes auraient été établis et traités dans le cadre d'institutions gérées par une communauté autonome d'intellectuels scientifiques : les académies et les universités. Le mode 2 se déploierait au contraire dans une multiplicité d'espaces, ceux de la technoscience contemporaine, dans un contexte où le marché et les usages structurent les questions et les manières de les traiter.
Pour préciser la nature de ces deux régimes, le livre de M. Gibbons dresse un tableau contrasté de leurs caractéristiques principales. Empruntons-lui quelques exemples d'oppositions. Le premier régime est centré sur l'université et le monde académique, le second est distribué entre ces mêmes universités et les laboratoires des entreprises, les firmes innovantes et les firmes de consultants, les « think tanks » et les réseaux ad hoc de normalisation. Dans ce mode 2, les chercheurs ont des origines, des formations, des traditions et des intérêts divers, et la circulation des hommes d'un lieu à l'autre est encouragée. Le premier régime est plutôt hiérarchique dans ses fonctionnements (du professeur aux doctorants), il est stable institutionnellement (du fait de la suprématie des structures d'enseignement et des financements étatiques), et il préfère les approches disciplinaires (les savoirs sont validés par des universitaires partageant les mêmes paradigmes - ceux de la physique des hautes énergies par exemple).
Le second se doit d'être au contraire plus souple dans ses formes d'organisation (les collaborations qui se créent sont orientées vers des questions ayant leur origine dans les besoins économiques ou la demande sociale et politique) ; et il lui faut mobiliser des ressources transdisciplinaires (les questions à résoudre exigent des compétences multiples). Le premier régime met l'accent sur le fait que les questions sont choisies par les savants eux-mêmes, sur l'autonomie du jugement scientifique et sur la valeur intrinsèque des résultats, tandis que le second met en jeu plusieurs manières de juger ces résultats : tel est retenu ici car il réussit techniquement, tel autre car il est encourageant pour tel problème pratique, tel troisième car il constitue une norme bien choisie. Ici, l'université et ses modes habituels de validation ne sont plus qu'un partenaire parmi d'autres. En forçant le trait, le premier mode évoque le monde académique assoupi tiré des images d'Epinal des nouveaux maîtres du marché, le second le monde actif des golden boys de la Silicon Valley.
Si je prends un ton quelque peu ironique pour clore ce résumé, c'est pour indiquer qu'une simplification est peut-être ici à l'oeuvre, une simplification qui ne se construit pas sans jugement de valeur politique. Dans le monde des partisans d'un libéralisme dérégulateur donné comme solution de tous les maux, l'idée d'adaptation constante au changement s'oppose en effet à celle de rigidité, bien sûr bureaucratique et étatique, la mobilité est évidemment préférable au corporatisme, l'échange et le transdisciplinaire au disciplinaire, le divers et le multicentré au hiérarchiquement organisé et unique, la disponibilité et l'utilité sociale au savoir dans sa tour d'ivoire : en un mot, l'ouvert au fermé et le bien au mal.
Les travaux les plus récents de l'histoire des sciences invitent fortement à reprendre cette opposition entre modes 1 et 2(I). Tout d'abord, ces deux modes de production des savoirs ne viennent pas chronologiquement l'un à la suite de l'autre : ils sont en réalité à l'oeuvre depuis plusieurs siècles, en parallèle, et ils décrivent des manières de pratiquer les sciences qui se sont souvent chevauchées. Cette remarque n'implique pas qu'il n'y ait pas de changement majeur dans la période récente, au contraire. Pour bien en juger, toutefois, il est important de ne pas poser une image de départ trop simpliste.
Le mode 2 de production des savoirs a par ailleurs été le mode dominant depuis deux ou trois siècles, si l'on choisit comme critère la masse de ce qui fut effectivement produit en termes théoriques et pratiques. Mais, le plus souvent, ceux qui ont prétendu travailler selon le mode 1 ont aussi été immergés dans des réseaux plus vastes du type mode 2. Enfin, les modes 1 et 2 ont aussi été des manières de se penser soi-même. Le discours affirmant que le mode 1 a été « le » mode de fonctionnement normal des sciences au cours des derniers siècles, discours qui n'a pris sa forme définitive qu'au XIXe siècle, a joué en effet le rôle d'un discours normatif.
Il nous a permis à nous, universitaires occidentaux, de maintenir notre supériorité en soutenant que nos savoirs savaient toujours séparer la réalité des chimères, ce que les autres cultures - que nous colonisions - étaient incapables de faire. Il nous a aussi permis de nous placer au-dessus des intérêts partisans - la science pure est un savoir élaboré dans un espace neutre socialement, celui des académies et des universités - et de ne pas être tenus pour responsables des mauvais usages faits de nos découvertes par les autres, principalement les politiques et les industriels.
Même s'il existe un héritage de la tradition philosophique médiévale, qui a son lieu principal dans les académies et les universités, et se donne comme but l'élaboration de systèmes de propositions cohérents, la pratique effective des sciences dans les derniers siècles ne doit donc pas être identifiée au seul mode 1. Pour les XVIe et XVIIe siècles, par exemple, les constructeurs d'instruments, les cartographes, les astronomes, les artilleurs, les ingénieurs de fortifications, les arpenteurs et les navigateurs appartiennent à un même monde, celui des « mathématiques mixtes ». Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les sciences expérimentales ont des dimensions techniques évidentes et sont développées à l'Académie royale parisienne tout autant que dans les sites proto-industriels, à la Royal Society comme autour du marché londonien(I). Le contexte d'élaboration de ces savoirs peut être souvent dit d'application*, dans la mesure où il est articulé sur la maîtrise pratique des choses et où il implique la conception, la construction et la distribution de machines et d'instruments dont la pertinence est évaluée « localement » : une cour princière allemande jugera de l'intérêt d'une pompe avec d'autres critères qu'un propriétaire de mines ou qu'un concepteur de jardins royaux, et ce qu'est une démonstration ou une preuve réussie varie d'un lieu à l'autre.
L'appel à l'Etat, au marché ou aux entrepreneurs financiers a toujours été monnaie courante(2). L'irruption des machines hydrauliques et des machines à vapeur constitue un exemple canonique pour la première moitié du XVIIIe siècle. L'implication de Boyle et de Newton avec la Compagnie des Indes orientales, celle de Desaguliers et Hooke avec le marché des instruments, celle encore de Newton avec la Monnaie ne sont que trois autres exemples montrant la variété des réseaux mis en place en Angleterre, la multiplicité des lieux dans lesquels les « applications » occupent une place centrale dans la production des savoirs. Plus habituelle en Angleterre, notamment à Londres, ces manières de pratiquer la science prennent des formes différentes en France, où les académiciens font en quelque sorte partie de l'Etat. Ici, Buffon, Réaumur, et bien d'autres, peuvent envisager des schémas de réorganisation sociale ou économique, prétendre avoir les moyens scientifiques de rendre plus efficaces les savoirs artisans et populaires, et suggérer de rationaliser, pour le bien du royaume dans son ensemble et contre les intérêts étroits des corporations, l'ensemble des processus de production. Défendant le monde atomisé des Lumières, ils avancent des solutions « éclairées » à mettre en oeuvre sous leur direction. Avec les praticiens des mathématiques mixtes, ils collaborent avec les ingénieurs, militaires ou civils et dressent les cartes du Royaume, améliorent les moyens de navigation : ils travaillent dans le même mouvement sur la frontière des savoirs, pour le développement technique et pour le progrès social(3).
Au cours des XIXe et XXe siècles, les connaissances accumulées dans les universités gagnent en pertinence pour les savoirs produits dans les ateliers des constructeurs d'instruments, les laboratoires des entreprises industrielles, les bureaux des ingénieurs-conseils, les arsenaux. Pour la seconde moitié du XIXe siècle, la chimie, la télégraphie, l'électricité et la radio sont des cas d'école. A titre d'exemple, mentionnons ici quelques éléments à propos de la télégraphie transatlantique. Lord Kelvin, le plus grand philosophe naturel du Royaume-Uni, est le centre de ces sciences pratiques, et James Clerk Maxwell lui-même, le fondateur de la théorie électromagnétique, contribue directement, techniquement et théoriquement au projet impérial de réseau de câbles, via l'Association britannique pour l'avancement des sciences. Les deux hommes s'impliquent étroitement avec les milieux politiques et les milieux d'affaires, avec la finance et l'industrie nouvelle. Kelvin est directement lié aux compagnies qui posent les câbles, et ses buts sont, dans le même mouvement et sans qu'une distinction soit vraiment possible, de faire progresser les savoirs sur l'électricité et de gagner de l'argent, de promouvoir la science et de développer la puissance des compagnies et de l'Empire britannique. Des remarques similaires pourraient être faites sur la question des standards et des normes techniques et industrielles, indispensables à l'expansion économique et aux volontés hégémoniques, illustrant ainsi la nature très large des réseaux dans lesquels les scientifiques travaillent(4).
On pourrait aussi considérer des secteurs moins prestigieux, par exemple celui des conserves alimentaires. Des confiseurs, constructeurs de boîtes de conserve, métallurgistes, soudeurs, officiers de marine et savants (des chimistes comme des biologistes) sont partie prenante, tout au long du XIXe siècle, de cette industrie nouvelle. Certes, les savants ne sont pas tous impliqués de la même façon. Gay-Lussac, par exemple, n'est pas en interaction active avec les fabricants, qui l'utilisent pour donner plus de crédibilité aux techniques qu'ils développent, si ce n'est lorsque, expert nommé dans les comités officiels, il juge de la qualité des produits. Pasteur se comporte en revanche de façon très différente, ce qui ne surprendra pas ceux qui connaissent son oeuvre, et Liebig, en Allemagne, s'implique encore plus directement dans le développement de ces produits « high tech ». Ce dernier cas déploie toutes les caractéristiques du mode 2 : l'efficacité pratique est au centre des préoccupations, l'objectif est de réussir des conserves de longue durée dans un contexte de compétition commerciale, et pour y parvenir, il est nécessaire de mobiliser des alliés les plus divers apportant chacun des savoirs et des savoir-faire complémentaires(5).
Pour le XXe siècle, citons un seul exemple, celui de Marie Curie. Le cas est intéressant car il montre combien on se leurre lorsqu'on identifie spontanément science et mode 1, lorsqu'on croit trop fermement à l'autonomie du monde de la science. Marie Curie est certes une scientifique dédiée à la science pure : comme nous le savons, elle refuse de prendre des brevets et offre ses découvertes à l'humanité. Elle n'en est pas moins à l'origine de l'industrie de la radioactivité en France, elle en est l'acteur premier et militant. Elle conçoit elle-même l'industrialisation des procédés de fabrication et de purification des substances radioactives, ses collaborateurs créent des compagnies ou deviennent ingénieurs-conseils d'entreprises manufacturant les produits et les instruments développés au laboratoire, elle joue un rôle personnel dans la métrologie de la radioactivité (pour la médecine comme pour l'industrie) et elle prend en charge la fabrication des standards indispensables à la socialisation du radium. Certes elle montre une préférence, plus générale dans les milieux scientifiques français, pour les solutions semi-publiques, mais elle choisit d'aider à la constitution d'une industrie privée, condition nécessaire du développement économique et du progrès social qu'elle appelle de ses voeux(6).
En résumé, le livre de M. Gibbons devrait être considéré comme une invitation à penser plus finement la variabilité de ces interactions entre mode 1 et mode 2 au cours du temps historique, et non comme une réponse définitive. Sur un autre plan, l'ouvrage avance toutefois une thèse plus large concernant la transdisciplinarité et les comptes que la science doit rendre au social aujourd'hui. Elle énonce que les disciplines académiques, telles qu'elles sont définies par l'enseignement universitaire, sont de moins en moins les cadres organisateurs de la recherche actuelle. La dynamique des savoirs n'est plus principalement créée de l'intérieur des disciplines, et la recherche scientifique trouve de plus en plus de stimulants à l'extérieur du cadre disciplinaire universitaire. Parce que les lieux de production des sciences sont de plus en plus divers et dépendants du monde économique, parce que les questions posées aux scientifiques ont de plus en plus leur origine dans le marché ou dans des nécessités politiques de régulation, les approches sont souvent transverses par rapport aux disciplines.
A ce niveau de généralité, la thèse dit plusieurs choses de vrai et de capital : par exemple que la dynamique des sciences a des moteurs variés. Il s'agit parfois de questions intellectuelles surgies de l'intérieur d'une recherche, mais parfois aussi du monde technique. Il s'agit souvent de logiques instrumentales : la maîtrise d'un savoir-faire qu'on souhaite rendre opératoire ou importer dans son domaine. Il s'agit encore de la logique des systèmes, vivants ou techniques, qu'on utilise, ceux qu'on sait manipuler et qui constituent les outils à partir desquels on pense et expérimente (songeons à la drosophile pour la génétique). Tout cela est donc vrai mais n'est en rien propre aux sciences de cette fin de siècle, même si le phénomène prend des formes très extrêmes aujourd'hui. Par ailleurs, tout ceci n'est pas vrai au même titre pour tous les domaines, et n'a pas nécessairement à l'être : depuis un siècle, la physique, qui va de la radioactivité à l'étude des particules élémentaires a une logique de développement beaucoup plus endogène (et elle continue à l'avoir) que la science des matériaux, qui a toujours connu une très grande diversité de ses objectifs intellectuels, de ses outils pratiques et de ses lieux de production. Enfin, cela n'implique pas que nous n'ayons qu'à suivre la tendance : on peut vouloir maintenir l'enseignement philosophique ou la recherche mathématique pour eux-mêmes, par exemple, car il n'est pas qu'une forme de « bon savoir », et choisir reste un droit politique.
M. Gibbons et ses collègues ont toutefois en tête quelque chose qui est plus spécifique au monde contemporain lorsqu'ils parlent des domaines de recherche concernant les études sur l'environnement et sa gestion, l'introduction des organismes génétiquement modifiés, la reproduction humaine techniquement assistée, les mesures d'impact des technologies, le nucléaire et la question des déchets, les grands équilibres de la planète (effet de serre, trou d'ozone, évolutions climatiques), etc. Ici, transdisciplinarité a un autre sens puisqu'il s'agit de mobiliser des ressources diverses pour penser le futur de l'espèce ou de la planète, puisqu'il s'agit d'analyses en temps réel pour l'action immédiate, d'analyses qui ne peuvent se mener qu'en lien avec le politique et qui doivent déboucher sur des propositions d'actions. Il ne s'agit donc plus seulement de faire collaborer des scientifiques d'origines diverses autour d'une même question, comme dans la science des matériaux. Le cas de la célèbre vache folle exemplifie ces questions à traiter dans l'urgence et qui sont organiquement liées aux pratiques industrielles et aux choix économiques et politiques.
Ici, les sciences sont souvent les acteurs premiers : ce sont elles qui mettent en branle les choses en développant des outils techniques pouvant déstabiliser notre univers. Mais elles sont aussi les acteurs de fin de cycle : on demande à la science d'aider à régler ce qu'elle-même a déplacé. Les problèmes sont ainsi définis de l'extérieur (un drame sanitaire non anticipé surgit, un groupe de pression refuse une solution technoscientifique particulière...), ils se déploient dans une temporalité définie par les exigences sociales et politiques, et non par celles de la recherche scientifique académique, ils s'apprécient selon des critères nécessairement variés d'un groupe à l'autre, irréductiblement conflictuels puisque reflétant des choix de vie opposés. La transdisciplinarité n'est donc plus alors qu'un élément, et pas nécessairement le plus intéressant ni le plus décisif, de questions plus larges qui sont celles des choix que la société veut faire pour son avenir, et des formes que doit prendre le débat démocratique.
Le point soulevé par M. Gibbons et ses collègues devient alors capital. Certes les experts et les scientifiques ont un rôle central à jouer dans ces débats, par définition pourrait-on dire, mais les enjeux sont tels qu'ils ne peuvent y être les seuls intervenants, ni les seuls juges. La technoscience et le monde industriel qui lui est lié ont en effet la capacité de transformer
si radicalement le monde naturel et le monde social que la question devient pleinement une question citoyenne. Il ne s'agit pas ici de mouvements ou d'attitudes anti-science, mais de volontés qui s'expriment dans des sociétés de plus en plus éduquées scientifiquement, de plus en plus désireuses de maîtriser leur destin, et qu'il est sage de respecter démocratiquement. Que l'ensemble du corps social souhaite contrôler toutes les potentialités qui lui sont offertes n'est nullement négatif et ne relève pas d'un refus du rôle que la science peut jouer. Il est au contraire riche des plus grandes potentialités, et nous, scientifiques, devons apprendre à y intervenir avec justesse, en débattant de la façon la plus publique possible, sans faire comme si nos savoirs seuls suffiraient pour trancher les questions. La science pourra alors parler utilement, contribuant à la définition des alternatives et, on peut légitimement l'espérer, sans déclencher de rejet violent.
(1) M. Gibbons et al., « The New Production of Knowledge : The Dynamics of Science and Research » in Contemporary Societies, Sage, 1993.
(2) L. Stewart, T he Rise of Public Science, Cambridge, Cambridge University Press, 1992.
(3) L. Hilaire-Pérez, , « Invention, politique et société en France dans la seconde moitié du XVIIIe siècle », Revue d'histoire moderne et contemporaine, 37, 36, 1990 ; C. Licoppe, La F ormation de la pratique scientifique, Paris, La Découverte, 1996 ; P. Minard, « Les inspecteurs des manufactures en France, de Colbert à la Révolution française », thèse, Paris I, 1994.
(4) C. Smith, N. Wise), Energy and Empire, William Thomson, Lord Kelvin, 1824-1907, Cambridge, Cambridge University Press, 1989.
(5) F. Martin, « La conserve », mémoire de DEA, université de Paris VII.
(6) S. Boudia, « Marie Curie et son laboratoire ; science, industrie et métrologie de la radioactivité en France, 1896-1914 », thèse de doctorat, Paris VII.