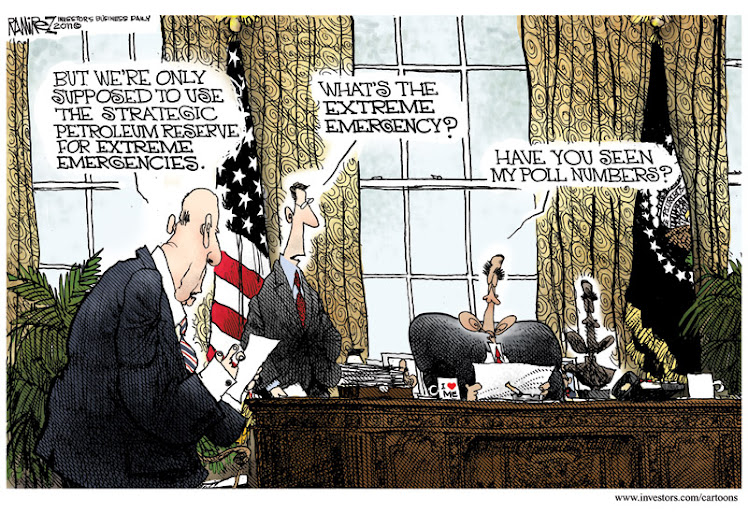Ils
y croyaient encore. Jeudi soir, lors de la fermeture des bureaux de
vote, les europhiles britanniques se sont couchés confiants en regardant
le dernier sondage qui donnait le camp du « Brimain » (celui du
maintien dans l'Union européenne) gagnant. Le réveil a dû être beaucoup
plus dur. Le « Brexit» est finalement sorti vainqueur des urnes ce
vendredi matin (51,9% des électeurs ont voté pour le « leave ») et le
premier ministre David Cameron, qui avait utilisé cette promesse de
référendum pour conquérir les voix eurosceptiques avant de faire
campagne pour le « remain », vient d'annoncer sa démission.
Il y a un an, une
telle issue paraissait encore impensable. Mais, depuis quelques mois,
le camp du Brexit, affaibli par la mise en cause de David Cameron dans
le scandale du Panama Papers, n'avait cessé de gagner du terrain. Et
l'entrée en campagne du très populaire et très fantasque ex-maire de
Londres, Boris Johnson, qui a soutenu de tout son poids politique et
médiatique la rupture avec l'Union, a renforcé ce mouvement. Il est vrai
que ce résultat ne tombe pas du ciel : nos amis britanniques n'ont
jamais porté l'Union dans leur cœur. A peine entrés dans la Communauté
économique européenne, ils organisaient déjà un référendum pour en
sortir. Depuis, leurs griefs se sont accumulés (trop de réglementation,
trop de migrants, trop de coûts de fonctionnement) et l'Europe était
depuis longtemps montrée du doigt comme la cause de tous les maux.
A
première vue, leur défection n'a aucune raison de nous réjouir. D'abord
parce que le Royaume-Uni était un membre important de l'Union,
contributeur net au budget de Bruxelles, ainsi qu'une puissance
diplomatique et militaire de premier plan, difficilement remplaçable,
surtout en ces temps troublés. "Dans une période de tempête, il n'est
pas bon qu'un membre de l'équipe se désolidarise", regrette Guillaume
Klossa, président du think tank EuropaNova.
Ensuite
parce que nos voisins d'outre-Manche risquent de subir une catastrophe
économique, et qu'il n'est jamais réjouissant de voir l'un de ses
partenaires commerciaux souffrir. "Pour les Anglais, l'ajustement causé
par une sortie du marché unique sera très douloureux", prévient Patrick
Artus, chef économiste chez Natixis.
Ce Brexit
ouvre en effet une longue période d'incertitude, car il va leur falloir
renégocier un accord de libre-échange avec l'Union européenne. Si, au
bout de deux ans, aucun compromis n'est trouvé, les traités actuels
cesseront de s'appliquer, à moins que les pays européens ne décident à
l'unanimité de les prolonger. Connaissant l'habitude de nos dirigeants
de s'enliser dans les négociations à Bruxelles, ce scénario du pire ne
serait guère étonnant : selon de nombreux experts, l'affaire pourrait
traîner pendant une décennie !
Autant dire que nos voisins d'outre-Manche peuvent se préparer à des lendemains difficiles. Chute de la livre (après l'annonce de la victoire du Brexit, elle a perdu en quelques heures plus de 10% face au dollar
et atteint son point le plus bas depuis 1985), instauration de droits
de douane, effondrement des exportations, affaiblissement des entrées de
capitaux... Au total, l'économie britannique pourrait perdre jusqu'à
100 milliards de livres et presque 1 million d'emplois d'ici 2020, selon
les calculs de la CBI (Confédération of British Industry), la
principale organisation patronale du pays. Sans parler du divorce avec
l'Ecosse, très attachée à l'Union (et qui a voté majoritairement en
faveur du « Remain »), qui voudra peut-être plier bagage...
Pour nous, en revanche, l'affaire
pourrait se révéler plutôt payante sur le front de l'emploi et de la
croissance à long terme. Un Brexit pourrait en effet pousser entreprises
et investisseurs à fuir le Royaume-Uni, jusque-là considéré comme une
porte d'entrée privilégiée dans l'UE grâce à son marché du travail
ultra-flexible, sa fiscalité très attractive et sa stabilité financière.
Londres accueille 40% des sièges sociaux européens des 250 plus grandes
multinationales.
Les sociétés de la finance
pourraient être les premières tentées de faire leurs valises. "Le Brexit
va peser sur l'activité de La City en tant que plaque tournante de
l'Union européenne", reconnaît Paul McGhee, directeur de la stratégie de
l'AFME (Association for Financial Markets in Europe). Bruxelles risque
fort, en effet, de se montrer intraitable lors des négociations sur la
question des services financiers. La BCE avait déjà essayé une première
fois de rapatrier les transactions en euros sur le continent (40% se
font à Londres), mais elle s'était heurtée à un refus de la Cour de
justice de l'Union européenne, au motif que le Royaume-Uni était un Etat
membre. Maintenant que cette raison s'est envolée, on doute que
Bruxelles laisse passer cette belle occasion de récupérer certaines
activités...
Très certainement privés du
"passeport" qui leur permet, une fois agréés dans un Etat membre,
d'exercer leurs activités dans les autres pays européens, et incapables
de prévoir les conséquences réglementaires et juridiques de ce
changement de situation, un certain nombre d'établissements financiers
avaient déjà commencé à se poser la question de leur déménagement avant
le vote. HSBC avait prévenu qu'en cas de rupture avec l'UE, elle
transférerait 20% de ses effectifs (soit 1.000 personnes) à Paris.
D'autres, comme la Deutsche Bank, ont déclaré réfléchir sérieusement à
un déplacement de certaines activités. Pour les membres de la zone euro,
le gâteau à se partager est plutôt appétissant : sur les 12.700
établissements du secteur présents à Londres, plus de la moitié sont des
sièges européens de sociétés étrangères.
Mais
la délocalisation d'activités pourrait aussi concerner l'industrie.
Selon une enquête menée avant le vote par la Bertelsmann Foundation
auprès de plus de 700 entreprises britanniques et allemandes présentes
au Royaume-Uni, quasiment un tiers d'entre elles se disaient prêtes à
réduire leur activité ou à la délocaliser en cas de Brexit.
"Ces
sociétés vont subir une perte de chiffre d'affaires et de
profitabilité", prévoit Ana Boata, économiste et spécialiste de la zone
euro chez Euler Hermes. Les firmes qui exportent beaucoup vers les
autres pays de l'Union, en particulier, auront tout intérêt à se placer
au plus près de leurs consommateurs pour éviter d'avoir à supporter le
poids d'éventuels droits de douane.
Premiers touchés, les
constructeurs automobiles (45% de leur production est destinée au Vieux
Continent), dont les très faibles marges seraient vite grignotées en
cas d'établissement de barrières tarifaires. Selon le think tank Open
Europe (eurosceptique), ces dernières pourraient en effet atteindre les
10% si l'Union européenne et le Royaume-Uni ne se mettent pas d'accord !
"Nissan et Toyota iront très certainement faire leurs investissements
ailleurs", estime Iain Begg, professeur à la London School of Economics.
Les
sociétés du secteur de la chimie (où les droits de douane pourraient
monter à 4,6%) ou de l'agroalimentaire (plus de 20%) seraient elles
aussi tentées d'aller chercher des cieux plus cléments. "Des milliers
d'emplois vont être transférés de l'autre côté du Channel", s'inquiète
Tony Burke.
Et la ville qui pourrait tirer le
plus son épingle du jeu est... Paris ! Selon Standard & Poor's,
notre capitale est en effet très bien placée pour devenir la première
place financière de l'Union, même si Francfort - qui abrite la Banque
centrale européenne - frétille également à l'idée de récupérer une
partie des activités de la City.
Des premiers
signes avaient d'ailleurs déjà commencé à se faire sentir le long de la
Seine depuis quelques mois. "De plus en plus de banquiers, d'avocats et
d'expatriés se renseignent pour acheter à Paris", avait remarqué Laurent
Demeure, président de Coldwell Banker France et Monaco, un réseau
spécialiste de l'immobilier de prestige, lorsque nous l'avons interrogé
au mois de mars. Même son de cloche du côté de la mairie de Paris et
d'Europlace, l'organisme qui regroupe les marchés financiers français :
des entreprises et des banques s'informaient déjà sur les avantages que
pourrait leur offrir la Ville lumière en cas de Brexit.
"Nous
sommes prêts à leur dérouler le tapis rouge", glisse Jean-Louis
Missika, adjoint à l'urbanisme, dans une allusion à David Cameron, qui
promettait il y a quelques années la même chose aux entreprises
françaises. "Paris dispose de beaucoup d'atouts pour séduire les groupes
internationaux qui souhaitent développer une présence dans l'UE",
renchérit Arnaud de Bresson, délégué général de Paris Europlace.
Naturellement,
d'autres zones de l'UE espèrent elles aussi récupérer des
investissements et des emplois. Des pays de l'Est (en particulier pour
l'automobile) à l'Espagne (avec son coût du travail devenu attractif),
en passant par le Luxembourg, les Pays-Bas ou l'Irlande (qui bénéficie
des mêmes atouts que sa voisine britannique), tous ont commencé à faire
la danse du ventre. Comme le constate Charles Wyplosz, professeur
d'économie internationale à l'Institut de hautes études internationales
et du développement, "tout le monde rêve de prendre des parts de marché
aux Anglais en cas de Brexit". Autant dire que la compétition risque
d'être acharnée.
N’importe, par delà ces
rivalités, cette défection du Royaume-Uni pourrait peut-être faire du
bien à l'Union européenne tout entière. D'abord parce qu'elle va devoir
enfin ouvrir les yeux et regarder ses défauts en face. "Les Anglais
n'ont pas que de mauvaises raisons de s'en aller !", tempête Charles
Wyplosz. Normes absurdes, bureaucratie tatillonne, incapacité chronique à
gérer les crises, il y a de quoi vouloir prendre ses cliques et ses
claques... Le tremblement de terre du Brexit aura sûrement de quoi
pousser à un changement de cap.
Surtout, le
départ des Anglais sonne comme une libération pour les Etats qui rêvent
d'approfondir l'Union, à commencer par la France et l'Allemagne.
"Londres a toujours tout refusé et s'est contenté de nous utiliser pour
faire son marché", s'agace l'eurodéputée Virginie Rozière. De fait,
enkystés dans leur refus de toute intégration supplémentaire et dans
leur conception a minima de l'UE - ils n'y ont jamais vu autre chose
qu'une simple grande zone de libre-échange - nos amis britanniques nous
ont conduits à privilégier l'élargissement au détriment de
l'approfondissement.
Du coup, sur certains
sujets, comme l'intégration plus poussée de la zone euro ou
l'harmonisation de la fiscalité, leur disparition de la scène pourrait
enfin permettre d'avancer. "On pourrait profiter de l'occasion pour
créer une ressource propre à l'Union afin de remplacer la contribution
britannique", suggère Jérôme Creel, économiste à l'OFCE.
Ajoutons
que le choix du Brexit par les Anglais est sans doute la meilleure
façon de faire taire les eurosceptiques. C'est en tout cas la thèse des
prévisionnistes de Bank of America et de Merrill Lynch : selon eux, les
conséquences économiques pour le Royaume-Uni seront en effet tellement
désastreuses que cela dissuadera tout autre pays d'envisager de claquer
la porte. En particulier ceux de la zone euro, par nature encore plus
exposés à un divorce, ou ceux qui dépendent largement des subventions
européennes, comme les nations de l'Est.
Histoire
d'enfoncer le clou, "la France et l'Allemagne vont d'ailleurs être
tentées de se montrer très sévères lors des négociations avec le
Royaume-Uni", prévient Philippe Chalon, secrétaire général du Cercle
d'outre-Manche, un think tank de dirigeants d'entreprises
franco-britanniques.
Reste une dernière raison
de nous réjouir d'un lâchage du pays du bacon : les petits génies
français du ballon rond qui évoluent dans les équipes de football
britannique auront à nouveau besoin d'un visa pour fouler les pelouses
anglaises. Comme les conditions d'attribution de ce sésame ont été
récemment durcies, certains d'entre eux seraient sans doute contraints de lâcher les Arsenal, Manchester et autres pour revenir jouer chez nous.
La mauvaise nouvelle, par contre, c'est que cela ne change rien pour
l'Euro et que nous risquons toujours d'affronter les Anglais en quart de
finale. On ne peut pas être gagnant sur tous les tableaux.