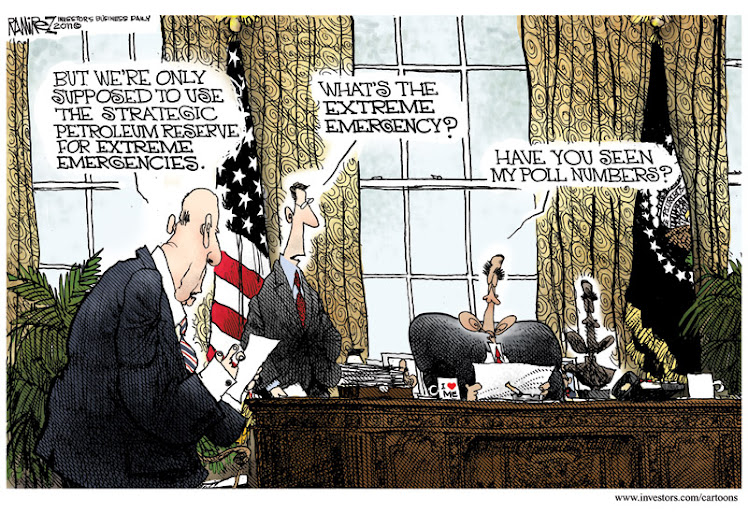Convoquant
dans « Numéro zéro » le fantôme de Mussolini et le thème du complot,
cher à son cœur, Eco raconte cette Italie qui pensait impossible
l’arrivée au pouvoir d’un Berlusconi. Entretien.
HD. Votre roman se déroule en 1992, l’année où a démarré en Italie l’opération « Mains propres », « Mani pulite »...
Umberto Eco. D’un côté, devant parler du
passé de l’Italie depuis 1945, il fallait que je m’arrête pour ne pas
couvrir un espace temporel trop long. De l’autre, 1992 a été une année
pivot pour la société italienne. On pensait que tout allait changer
parce qu’on faisait de grands procès contre la corruption. Deux ans
après, il y a eu la prise du pouvoir par Berlusconi. Rien n’a donc
changé, c’est même devenu pire. Cette année est intéressante. Et
m’arrêter en 1992 permet aux lecteurs de faire eux-mêmes
l’interprétation de ce qui s’est passé ensuite.
HD. Pourquoi avoir écrit un roman plus accessible aujourd’hui ?
U. E. En vieillissant, on devient plus sage.
On n’a pas besoin de montrer qu’on sait tout. C’est mon roman le moins
érudit. Mes romans précédents étaient des symphonies de Mahler. Celui-ci
est plus jazz. C’est du Charlie Parker ou du Benny Goodman. Dans mes
romans, le style suit toujours le sujet. Le style du « Nom de la rose »
était celui d’un chroniqueur médiéval. Celui de « l’Île du jour d’avant »
était baroque. « Numéro zéro » suit le style journalistique, très sec.
Comme je parle de la contemporanéité, il n’y a pas la surcharge de tous
les documents historiques, sauf pour les histoires liées à Mussolini qui
font ici quasiment partie de la contemporanéité.
HD. Le « fantôme » de Mussolini est omniprésent dans votre roman. Que représente-t-il dans l’Italie d’aujourd’hui ?
U. E. Mussolini est continuellement évoqué
car il ne faut pas oublier le fascisme. Ainsi, tous les soirs, la chaîne
RAI Histoire diffuse des documentaires historiques. Le fantôme de
Mussolini est encore présent. Mais il ne l’est pas tellement dans
l’opinion publique, sauf pour les groupes fascistes. En 1992, les
fascistes étaient encore marginaux. Après, Berlusconi les a
fait entrer au gouvernement. Ils se sont un peu attendris, tandis qu’à
leur droite surgissaient d’autres groupes plus radicaux comme
aujourd’hui Casa- Pound (1) qui, par certains côtés, sont des nazis.
Mussolini n’est donc pas dans mon roman parce qu’il représenterait une
obsession pour l’Italien moyen. Personne n’avait jamais avancé
l’hypothèse qu’il n’avait pas été tué, comme le fait l’un de mes
personnages, Braggadocio. Cela me faisait plaisir de démontrer qu’en
connectant des choses différentes, on peut toujours construire un
complot. D’ailleurs, par un épisode biographique curieux, je me trouve
lié à la mort de Mussolini pour deux raisons. J’étais devenu après la
guerre ami avec Pedro, le partisan qui l’a arrêté. Et lorsqu’on a révélé
que « colonel Valerio », celui qui a tué Mussolini, était le nom de
guerre de Walter Audisio, mon père a découvert qu’il était né dans ma
ville (Alexandrie, dans le Piémont – NDLR) et qu’il habitait à deux ou
trois blocs de chez moi. Les hommes qui ont arrêté et tué Mussolini
étaient liés dans ma mémoire par ces deux épisodes. Mais je voulais
construire un complot sur une histoire tellement improbable que même le
plus stupide des lecteurs n’aurait pu y croire – même s’il est toujours
possible d’en trouver un assez idiot pour croire aux complots.
« SUR INTERNET, JE NE SAIS PAS QUI PARLE. UN JEUNE NE PEUT PAS DISTINGUER UN SITE ANTISÉMITE D’UN SITE DÉMOCRATIQUE. »
HD. Pourquoi le quotidien dont il est question dans « Numéro zéro » a-t-il pour titre « Domani » (demain) ?
U. E. L’éditeur Angelo Rizzoli avait un
hebdomadaire qui s’intitulait « Oggi » (aujourd’hui – NDLR). Il a voulu
faire un quotidien homonyme. Pendant quatre ou cinq ans, il a fait un
numéro zéro (maquette réalisée en conditions réelles avant le lancement
d’un journal – NDLR). Sur un énorme gratte-ciel était inscrit: « “ Oggi
”, il quotidiano di domani » (« Oggi », le quotidien de demain – NDLR).
Il n’est jamais paru. Et comme dans le roman Simei, son directeur, dit
que son journal ne doit pas parler de ce qu’il s’est passé la veille, je
trouvais ironique de l’appeler « Domani».
HD. Quel regard portez-vous sur la presse italienne ?
U. E. Depuis les années 1960, j’ai écrit toutes
sortes d’essais et d’articles sur les vices de la presse, en particulier
la presse italienne. Mais même le « New York Times » place entre
guillemets n’importe quelle déclaration de l’homme de la rue, la
transformant en « fait », sous prétexte de séparer le « fait » du
commentaire. Tous les journaux le font. J’ai beaucoup écrit et polémiqué
à ce propos. Simplement, lorsque j’écris un essai, les gens s’en
fichent. Avec un roman, tout le monde fait attention aux problèmes. J’ai
représenté de façon grotesque la médiocrité des journalistes, mais
beaucoup de ces vices existent aussi dans la presse de qualité. De
grands directeurs de quotidiens en ont débattu en Italie. Quelqu’un a
suggéré d’employer mon livre comme manuel dans les écoles de journalisme
pour expliquer ce qu’il ne faut pas faire. Pourquoi le journalisme
tombe-t-il de plus en plus dans ces filets ? À cause de la crise qu’il
traverse, qui remonte à l’apparition de la télévision. Elle dit le soir
ce que le journal dit le lendemain matin. Le journal aurait dû
disparaître, sauf qu’il s’est « hebdomadairisé». Quand la télévision est
apparue, les journaux comportaient 8 ou 12 pages. Maintenant, ils en
ont 60. Au moment où il n’y avait plus rien à dire, ils ont augmenté
leur pagination avec des commentaires, des analyses ou bien en se
lançant dans les potins. La crise du journalisme est mondiale. D’où
l’apparition de suppléments avec des approfondissements et des enquêtes
qui peuvent se préparer sept jours à l’avance. Ce sont les efforts faits
par les quotidiens pour échapper à cette étreinte mortelle.
HD. Internet n’a-t-il pas accéléré le phénomène ?
U. E. La jeune génération ne lit plus les
journaux. Les jeunes ne lisent plus les quotidiens, ils vont chercher
les informations sur Internet. Mais sur Internet, il n’y a pas la
garantie du filtrage. Si je lis « l’Humanité », je connais la tendance
du journal. Je sais qu’elle est un peu différente de celle du « Figaro
»... Sur Internet, je ne sais pas qui parle. Je suis
potentiellement victime de toutes les falsifications et manigances
imaginables. Un jeune type ne peut pas distinguer un site antisémite
d’un site démocratique normal.
HD. À cette différence près que les jeunes sont nés avec Internet. Ne finissent-ils pas par savoir qui parle ?
U. E. Je ne crois pas qu’ils y parviennent
tous. Seuls ceux qui sont capables de faire une différence entre les
sites, d’exercer un esprit critique, le peuvent. Ce sont ceux qui ont
été dans les meilleures écoles. L’aristocratie est toujours la même.
HD. Maia Fresia, seule femme journaliste de la rédaction,
est en butte aux réactions machistes de ses collègues. Que révèle ce
personnage de la place des femmes dans la société italienne ?
U. E. Dans mes romans, une femme est
fréquemment le véhicule de la rationalité. Dans « le Pendule de Foucault
», c’est la femme de Casaubon qui comprend toutes les manigances. C’est
la même chose dans ce livre. Maia porte le fardeau du bon sens et de
l’humour. C’est ma façon d’être féministe. Cela reflète-t-il une
situation réelle ? Je ne crois pas. Dans le livre, il n’y a qu’une femme
alors qu’elles sont de plus en plus nombreuses dans les rédactions. Il y
a certes toujours du machisme mais mes journalistes sont un peu des
ratés.
HD. Comment avez-vous vécu l’année 1992 ?
U. E. J’étais excité, j’ai suivi tout à la
télé. On voyait les puissants de l’époque trembler. C’était du grand
spectacle très intéressant. C’était l’époque où on commençait à
comprendre que les socialistes du PSI de Bettino Craxi avaient exagéré
dans leurs envies de pouvoir. On était plus ou moins content. On croyait
qu’on allait en terminer avec la corruption, avec tout cela. Mais c’est
devenu pire. Dans ces années-là, on volait pour donner l’argent à son
parti, aujourd’hui, on vole pour garder l’argent pour soi. Ce
qui correspond à l’analyse de Zygmunt Bauman sur la « société liquide».
Il n’y a plus d’idéologie, de structures d’organisations communes
fondées collectivement. On ne s’identifie plus. Chacun veut paraître,
avant tout.
HD. Entre 1992 et aujourd’hui, Berlusconi a marqué la vie politique italienne. Qu’est-ce qui a changé ?
U. E. Quelque chose a changé en raison du
déclin, pas encore définitif, de Berlusconi. Son parti est en miettes.
Mais comme un chat, il a sept vies. Il peut encore trouver des façons de
se remettre en selle, même si je crois qu’en termes d’âge, il est
arrivé à son couchant. L’arrivée de Renzi a changé quelque chose. On
peut être d’accord ou pas avec lui, mais il a imprimé à la vie politique
italienne un rythme différent. Il a introduit la vitesse. La politique
italienne était un marécage tranquille.
Tout allait lentement. Avec Renzi, le rythme est devenu presque
frénétique. À cette vitesse, on fait toutes sortes d’erreurs. Mais il a
changé quelque chose. Il a renouvelé une partie de la classe dirigeante.
On lui reproche d’avoir mis dans le gouvernement des gens de 30 ans qui
manquent d’expérience. Mais lorsqu’on voit les bêtises faites par de
vieux types ...
« ON REPROCHE À RENZI DE FAIRE APPEL À DES JEUNES MAIS LORSQU’ON VOIT LES BÊTISES FAITES PAR DE VIEUX TYPES... »
HD. Qu’aimeriez-vous que la postérité retienne de vous ?
U. E. Je serai probablement perçu comme un
romancier. Mais en ce moment, « The Library of Living Philosophers » (La
bibliothèque des philosophes vivants – NDLR), une collection de livres
de 1 000 pages créée aux États-Unis en 1939, a décidé de me consacrer un
de ses ouvrages. Il y a eu Bertrand Russell, Einstein, Gadamer ou
Ricœur, parmi d’autres. Ils n’avaient plus personne. Ils ont donc décidé
de me consacrer un livre. Cela prend des années parce que vous devez
écrire une autobiographie philosophique de 50 pages. Après, une série
d’intellectuels reconnus écrivent des essais critiques sur vous et vous
devez répondre à chacun d’entre eux. Je vais peut-être mourir avant.
Cela risque de poser un problème car c’est la « library of living
philosophers » et pas des « dead philosophers » (philosophes morts –
NDLR)! Je considère cela comme une consécration. C’est mieux qu’un prix
Nobel pour les philosophes car pas un auteur dans cette série n’a été
oublié.
(1) Ce micro-parti d’inspiration néofasciste est très actif sur le
plan culturel et social. Il s’est appuyé sur la crise du logement pour
développer une façade humanitaire.
L' auteur du « Nom de la rose » (1980) et du « Pendule de Foucault »
(1988), s’intéresse depuis fort longtemps aux médias. Il a publié de
nombreux essais sur la linguistique, l’esthétique, la culture de masse
et la sémiotique. Il utilise dans « Numéro zéro » la forme romanesque
pour livrer une critique sarcastique de la sphère médiatique dans
l’Italie de 1992 où se déroule l’opération « Mains propres».
« Numéro zéro », d’umberto eco, éditions Grasset, 2015, 224 Pages, 19 euros.1992 à Milan. Universitaire raté, journaliste à la petite semaine, lecteur dans des maisons d’édition, nègre d’un auteur de série noire, Colonna se rêve écrivain. Avant de voir son nom apparaître sur une couverture, il doit encore patienter. Il a accepté l’offre rémunératrice de Simei, rédacteur en chef de « Domani », un quotidien en instance de création. Sous la signature de son patron, il s’apprête à rédiger un livre autour de la naissance du nouveau titre. Mais avec son supérieur, il est le seul à savoir que ce journal ne verra jamais le jour. De sa place privilégiée, il observe, raconte le double jeu de Simei, capitaine d’un navire qui semble très vite prendre l’eau. Il évoque le désarroi de journalistes attelés à la préparation du numéro zéro – maquette qui précède le lancement –, conscients du caractère manipulateur de leur publication, jusqu’au délire complotiste de l’un d’entre eux, persuadé que Mussolini n’a pas été fusillé en 1945. Umberto Eco offre dans ce roman un regard sarcastique sur l’univers politico-médiatique préberlusconien.